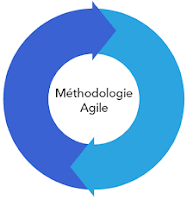Un projet de développement ou de refonte d’un site web n’est jamais anodin, a fortiori s’il s’agit d’un site marchand. Cependant, nombre de projets de développement de sites web “dérapent” et font naître des frustrations entre client et prestataire, pouvant aller jusqu’au contentieux. La jurisprudence dans ce domaine est abondante. Une nouvelle affaire est venue l’enrichir avec l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 8 décembre 2016, opposant une société du secteur de l’événementiel à un prestataire de développement web. (1)
Insatisfaite du site livré, la société cliente a engagé une action devant le tribunal de commerce de Marseille, en résolution du contrat de création de site internet pour manquement, par le prestataire, à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce, puis la cour d’appel l’ont déboutée de son action en résolution, faute de démonstration d’une inexécution de son engagement par le prestataire. Il ressort de cette affaire que la société cliente n’avait pas clairement défini ses besoins et qu’elle n’a pas apporté les éléments de preuve à l’appui de ses allégations.
1. La définition des besoins, préalable indispensable à l’exécution du projet
- Le contrat et son exécution
En octobre 2012, la société Open Up a accepté deux devis de la société Simpliciweb pour réaliser la refonte de son site web en format adaptable aux appareils mobiles (responsive design), et fournir une prestation de maintenance.
La livraison du site était prévue pour le 14 décembre 2012, sous réserve que le prestataire dispose de tous les éléments nécessaires à la réalisation du projet (maquettes, contenus) avant le 5 novembre. Dans le cas contraire, le délai de livraison du site était fixé trois mois après la réception de tous ces éléments.
Entre décembre 2012 et mars 2013, les parties ont échangé de nombreux emails concernant la fourniture des visuels par le client, les demandes de modifications et la validation des prestations réalisées.
Le 29 mars 2013, le prestataire envoyait un procès-verbal de réception du site. Celui-ci n’ayant pas été contesté par le client dans un délai de 15 jours, Simpliciweb a estimé que le site était livré.
Toutefois, considérant que Simpliciweb avait manqué à ses obligations contractuelles, la société Open Up lui a adressé un courrier de résiliation unilatérale des contrats le 30 avril 2013. Le 2 mai, Simpliciweb a mis le client en demeure de lui régler le solde des sommes dues pour la création du site. Open Up a refusé de régler et a assigné Simpliciweb devant le tribunal de commerce de Marseille en résolution du contrat de création de site web et caducité du contrat de maintenance. Par jugement du 25 avril 2014, le tribunal a débouté la société Open Up de toutes ses demandes. Cette dernière a ensuite fait appel de ce jugement.
Les arguments de la société Open Up, pour justifier sa demande en résolution du contrat, étaient les suivants : livraison tardive du site, dysfonctionnements du site, manquement aux devoirs de mise en garde et de conseil du prestataire, et défaut de livraison de la version mobile du site.
- Une définition des besoins défaillante
Il ressort de l’analyse des faits (exécution du contrat) par les juges, que le client n’avait pas clairement défini ses besoins en amont du lancement du projet. Ce manque de préparation a conduit à des retards dans la remise au prestataire des éléments nécessaires pour la réalisation du site, à une redéfinition de la gestion du projet pour tenir compte de ces retards et de nouvelles demandes du client, et à un sentiment de frustration générale, ayant abouti au contentieux.
Ainsi, concernant la livraison tardive du site, le contrat stipulait que la date de livraison indiquée n’était valable que si le prestataire disposait de tous les éléments nécessaires à la livraison du projet avant une date butoire ; à défaut, le délai de livraison serait de trois mois après réception de ces éléments.
D’après les échanges entre les parties pendant la période d’exécution contractuelle, le client a repoussé la livraison des visuels (nécessaires à la refonte du site) à plusieurs reprises et a adressé plusieurs nouvelles demandes de fonctionnalités.
La Cour en conclut que “l’appelante (la société Open Up) ne peut sérieusement reprocher à l’intimée (la société Simpliciweb) de ne pas avoir respecté la date du 14/12/2012”, sachant a fortiori que la communication des éléments nécessaires au développement du site et les demandes de modifications et de nouvelles fonctionnalités se sont poursuivies jusqu’en mars 2013.
Pour gérer la communication tardive des éléments nécessaires au développement, et les nombreuses demandes de modifications et de nouvelles fonctionnalités, le prestataire a proposé de poursuivre le projet selon une méthode itérative (validation de l’avancement du développement du site page par page).
Les juges relèvent que “contrairement à ses assertions, ce n’est pas le choix du mode de développement “page par page” mais les innombrables demandes d’ajouts, de suppressions et de modifications formulées par la SARL Open Up qui ont retardé l’exécution par l’intimée de ses engagements.”
Enfin, les juges constatent que les éléments nécessaires au développement ayant été fournis au prestataire début janvier 2013, le délai de livraison de trois mois prévu dans le contrat a été respecté (site livré le 29 mars 2013).
Il ressort de cette analyse que les retards allégués peuvent être imputés à une défaillance du client dans la définition de ses besoins, préalablement au lancement du projet de refonte du site.
2. L’établissement de la preuve des manquements contractuels
Dans le cadre d’une action contentieuse, il ne suffit pas au demandeur de procéder par affirmations. Ses demandes doivent être étayées par des éléments de preuve. (art. 1353 al.1 nouv. c civ). L’administration de la preuve commence par la production du contrat, puis le cas échéant, par la communication d’éléments venant étayer les assertions relatives aux manquements aux obligations contractées.
- L’absence de preuve entraîne le rejet des demandes
En l’espèce, la société Open Up soutenait que le site comportait des défauts, le rendant inutilisable pour commercialiser ses prestations. Or, les juges ont relevé que la société Open Up ne procédait que par affirmations, sans fournir la moindre preuve à l’appui de ses allégations pour démontrer l’existence de dysfonctionnements.
Par ailleurs, selon la société Open Up, Simpliciweb aurait manqué à son devoir de mise en garde et de conseil concernant les lenteurs et inconvénients du développement du site en mode “page par page”. Cependant, les juges relèvent qu’Open Up ne fait qu’affirmer l’existence d’inconvénients, sans les lister, ni les prouver. L’existence éventuelle de ces lenteurs et inconvénients aurait pu être démontrée grâce à un constat d’huissier par exemple.
Enfin, le client prétendait que le prestataire n’avait pas livré la version mobile du site. Or, là encore, la société Open Up n’a versé aucun document au dossier à l’appui de ses allégations. En revanche, la société Simpliciweb a produit des photos de téléphone mobile et tablette, montrant que le site était visible sous ces formats mobiles.
Le juge a donc rejeté les allégations de l’appelante au motif que celle-ci n’a pas démontré une inexécution de son engagement par le prestataire. Le jugement de première instance, qui avait débouté la société Open Up de son action en résolution du contrat, a donc été confirmé en appel. Celle-ci est condamnée à régler le solde de la prestation, l’indemnité de résiliation prévue au contrat et le manque à gagner concernant le contrat de maintenance, signé mais non exécuté.
- La preuve entre commerçants est libre
Pour rappel, sauf exceptions, la preuve entre commerçants est libre (art. L.110-3 c com.). La preuve de faits et la démonstration d’argumentaires juridiques peuvent donc se faire par la production de documents, papiers ou électroniques, signés ou non (contrats, courriers, emails, factures), des rapports d’expert ou constats d’huissier, mais également par des attestations, témoignages, aveux, etc. (2) La valeur probante de ces différents éléments est laissée à l’appréciation du juge. Ainsi, en l’espèce, le juge a admis la valeur probante des photos de téléphone mobile et tablette montrant le site sous format mobile.
Néanmoins, en règle générale, les documents produits par soi-même pour établir la preuve ne sont pas admis (art. 1363 nouv. c civ.). Il est donc recommandé de produire des documents échangés entre les parties (courriers ou emails) et si nécessaire, de faire constater les éléments de preuve - résultats d’un développement web, dysfonctionnements, frais engagés, par un tiers (expert, huissier, commissaire aux comptes) pour s’assurer que ces éléments seront admis par le juge.
En conclusion, comme constaté dans la présente affaire, une définition des besoins insuffisante entraîne des risques de dérives sur les demandes de modifications et d’ajouts, sur les délais de livraison, et par conséquent sur le coût du projet. Or, tout projet informatique, y compris un développement web, requière une réelle implication du client, préalablement à son lancement, mais également pendant son exécution. L’alternative, pour un client ne souhaitant pas fixer ses demandes avant le début du projet, peut être d’opter pour un projet “agile”, pour autant que la taille et la complexité de ce projet le justifient, et sous réserve d’une grande rigueur dans son suivi.
Enfin, il convient de noter en l’espèce que la société Simpliciweb a demandé à titre reconventionnel la condamnation de la société Open Up à des dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale des relations commerciales. Or, en vertu des articles L.442-6 III al. 5 et D.442-3 du code de commerce, l’examen de cette demande en appel relève de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris. (3)
* * * * * * * * * * * *
(1) CA Aix en Provence, 8é ch. A, 8 décembre 2016, Open Up c. Simpliciweb
(2) Les principes généraux de la preuve ont été remaniés avec la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations), voir art. 1353 nouv. et s. c civ.
(3) CA Aix en Provence, 8é ch. A, 2 mars 2017, Open Up c. Simpliciweb
Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com
Mars 2017